 En ce jeudi qui prend, pour certains, la forme d’un jour férié inaugurant un repos de plusieurs jours, le son qui me vient est atypique dans la carrière des Red Hot Chili Peppers. Groupe de funk rock américain fondé en 1982 (oui, il y a quarante ans…), le quatuor a connu diverses compositions et une foultitude d’albums tous plus énergiques les uns que les autres. Le carton absolu qu’est l’album Blood Suger Sex Magik en 1991 les propulse au sommet de la notoriété mondiale, avec des singles emblématiques comme Give it away ou Under the Bridge. Neuf ans plus tard, tombe dans les bacs Californication, qui marque le retour dans la formation de John Frusciante, à ce jour le meilleur guitariste du groupe. L’album est bourré de pépites et alterne l’énergie originelle du groupe et des moments plus posés mais tout aussi denses. La galette a, de plus, le bon goût de se terminer avec notre pépite du jour.
En ce jeudi qui prend, pour certains, la forme d’un jour férié inaugurant un repos de plusieurs jours, le son qui me vient est atypique dans la carrière des Red Hot Chili Peppers. Groupe de funk rock américain fondé en 1982 (oui, il y a quarante ans…), le quatuor a connu diverses compositions et une foultitude d’albums tous plus énergiques les uns que les autres. Le carton absolu qu’est l’album Blood Suger Sex Magik en 1991 les propulse au sommet de la notoriété mondiale, avec des singles emblématiques comme Give it away ou Under the Bridge. Neuf ans plus tard, tombe dans les bacs Californication, qui marque le retour dans la formation de John Frusciante, à ce jour le meilleur guitariste du groupe. L’album est bourré de pépites et alterne l’énergie originelle du groupe et des moments plus posés mais tout aussi denses. La galette a, de plus, le bon goût de se terminer avec notre pépite du jour.
Road Trippin’ clôt l’ensemble de façon inattendue : une balade acoustique débarrassée de toute batterie pour trois minutes qui invitent autant à la douceur du soleil couchant qu’à prendre la route au petit matin. C’est à la fois paisible et un poil mélancolique, intimiste et propice aux retrouvailles en petit comité, inattendu et diablement efficace. Le texte parle de partir, de quitter la ville, de vivre pleinement le moment, de se vider la tête. De ressentir la vie, de prendre le temps, d’ensoleiller nos heures et de tout oublier sauf l’essentiel. Ce titre est parfait.
Road Trippin’ marque la fin de Californication, mais se trouve aussi être le début d’une jolie virée à faire où vous voudrez, quand vous voudrez, avec qui vous voudrez. Bref, Road Trippin’ est le titre idéal pour entrer dans quelques jours de repos. Et si vous ne faites pas partie de ceux qui bénéficient de ce weekend prolongé, rien ne vous interdit de l’écouter. Road Trippin’ est suffisamment bien fichu pour que vos oreilles et votre corps vous disent simplement merci. Dont acte. On y va ?
Raf Against The Machine
 Alors que le ciel reste désespérément gris ce dimanche, voilà un son qui va vous permettre de vous lover avec vous-même, tout en regardant la lumière au bout du tunnel. All my tears de Ane Brun affiche dix années au compteur, et fait pourtant partie de ces morceaux absolument intemporels qui fonctionnent en tout lieu et toute époque. Nous avions déjà rencontré Ane Brun sur ce blog, au travers de sa délicate et émouvante reprise de Big in Japan d’Alphaville (
Alors que le ciel reste désespérément gris ce dimanche, voilà un son qui va vous permettre de vous lover avec vous-même, tout en regardant la lumière au bout du tunnel. All my tears de Ane Brun affiche dix années au compteur, et fait pourtant partie de ces morceaux absolument intemporels qui fonctionnent en tout lieu et toute époque. Nous avions déjà rencontré Ane Brun sur ce blog, au travers de sa délicate et émouvante reprise de Big in Japan d’Alphaville (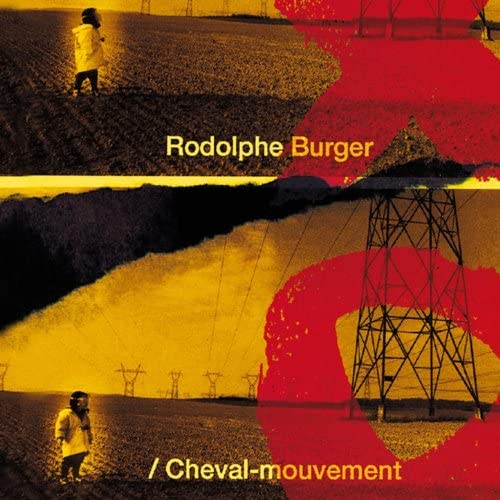 Tel est (re)pris qui croyait (re)prendre : au petit jeu des reprises, nous avons parlé la dernière fois de l’incendiaire version de Louie Louie par Iggy Pop (
Tel est (re)pris qui croyait (re)prendre : au petit jeu des reprises, nous avons parlé la dernière fois de l’incendiaire version de Louie Louie par Iggy Pop ( célébration un brin capitaliste des amoureux. Caroline Polachek sortait alors son deuxième opus Desire, I Want To Turn Into You qui m’obsède depuis bientôt 3 mois et sur lequel je prends aujourd’hui le risque d’écrire, tout en sachant que mes mots ne lui rendront pas suffisamment honneur. Membre du groupe de synthpop Chairlift avec Aaron Pfenning et Patrick Wimberly (un EP et trois albums tout de même que je serais bien intentionné d’aller réécouter pour raviver des souvenirs bien endormis en toute franchise), Caroline Polachek s’est lancé dans plusieurs projets solo sous le nom de Ramona Lisa ou CEP avant de sortir son premier album sous son nom en 2019 Pang qui est passé sous mon radar et qui méritera de figurer dans ma playlist estivale de rattrapage tant j’ai lu des avis dithyrambiques dessus…
célébration un brin capitaliste des amoureux. Caroline Polachek sortait alors son deuxième opus Desire, I Want To Turn Into You qui m’obsède depuis bientôt 3 mois et sur lequel je prends aujourd’hui le risque d’écrire, tout en sachant que mes mots ne lui rendront pas suffisamment honneur. Membre du groupe de synthpop Chairlift avec Aaron Pfenning et Patrick Wimberly (un EP et trois albums tout de même que je serais bien intentionné d’aller réécouter pour raviver des souvenirs bien endormis en toute franchise), Caroline Polachek s’est lancé dans plusieurs projets solo sous le nom de Ramona Lisa ou CEP avant de sortir son premier album sous son nom en 2019 Pang qui est passé sous mon radar et qui méritera de figurer dans ma playlist estivale de rattrapage tant j’ai lu des avis dithyrambiques dessus… Du haut de ses 45 ans de carrière (oui, depuis 1978) et de ses 57 ans (oui, déjà), Richard Melville Hall aka Moby n’en finit plus de nous délivrer des compositions qui sont aujourd’hui inscrites dans l’inconscient collectif. Qu’il s’agisse de l’énergique Honey, du délicat Porcelain, du viscéral Natural blues (tous trois sur l’incontournable album Play en 1999), ou encore du pop électro We are all made of stars et du groovy Extreme ways, titre BO de la saga cinéma Jason Bourne (présents eux sur 18 en 2002), nombre de ses morceaux sont devenus presque instantanément des classiques. Et nous ne regardons là que deux albums. On pourrait encore citer l’excellent Hotel (2005), ou plus récemment Reprise (2021), publié sur le prestigieux label Deutsche Grammophon habituellement dédié à la musique classique. Dans cet opus, Moby réenregistre 14 titres avec le Budapest Art Orchestra, démontrant ainsi la richesse et la profondeur de ses compositions. La démonstration n’est plus à faire. Moby est un grand artiste, et nous l’allons voir en revenant sur l’album 18 et In this world, un de ses titres phares.
Du haut de ses 45 ans de carrière (oui, depuis 1978) et de ses 57 ans (oui, déjà), Richard Melville Hall aka Moby n’en finit plus de nous délivrer des compositions qui sont aujourd’hui inscrites dans l’inconscient collectif. Qu’il s’agisse de l’énergique Honey, du délicat Porcelain, du viscéral Natural blues (tous trois sur l’incontournable album Play en 1999), ou encore du pop électro We are all made of stars et du groovy Extreme ways, titre BO de la saga cinéma Jason Bourne (présents eux sur 18 en 2002), nombre de ses morceaux sont devenus presque instantanément des classiques. Et nous ne regardons là que deux albums. On pourrait encore citer l’excellent Hotel (2005), ou plus récemment Reprise (2021), publié sur le prestigieux label Deutsche Grammophon habituellement dédié à la musique classique. Dans cet opus, Moby réenregistre 14 titres avec le Budapest Art Orchestra, démontrant ainsi la richesse et la profondeur de ses compositions. La démonstration n’est plus à faire. Moby est un grand artiste, et nous l’allons voir en revenant sur l’album 18 et In this world, un de ses titres phares.